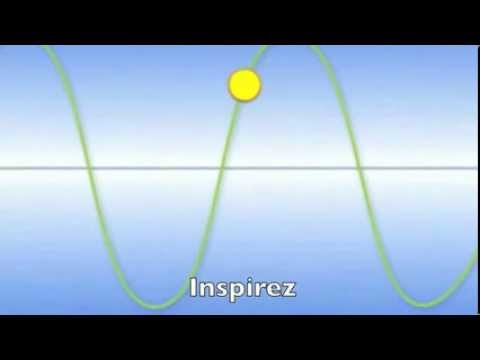Perdre un enfant, cris et dépassement
Sur un chemin de campagne ensoleillé, par un beau dimanche d’automne, deux autos se heurtent… mon fils compte parmi les morts, son père et moi, parmi les blessés graves. Je suis atteinte à la tête et mon mari souffre de multiples fractures. Hospitalisés pendant quelques mois dans la même chambre d’hôpital, nous ne reverrons plus jamais notre enfant. Je sais maintenant que la plus grande souffrance humaine qui puisse exister, c’est la mort de son enfant.
Jean-Philippe avait six mois. Mourir à cet âge, ce n’est pas dans l’ordre de la nature. Fernand Couturier parle de la mort de l’enfant comme d’une branche en fleurs qui se détache du tronc; que de fruits à jamais perdus. Non, ce n’est pas dans l’ordre des choses et cela tient du mystère… mystère douloureux qui vous déchire l’âme et qui vous met le cœur en miettes.
Jusqu’à l’automne 1980, je n’avais jamais véritablement vécu de deuil; mais, en sortant de mon coma, quelques jours après ce tragique accident, je devais me rendre à l’évidence que la vie ne serait plus jamais la même. Jean-Philippe m’avait fait vivre des moments qui ressemblaient au bonheur absolu. À partir de là, ce fut le soutien des parents et des amis qui m’aida à retrouver le chemin de la vie en consolant une mère qui ne l’était plus.
Lamartine a dit : Le malheur ouvre l’âme à des Lumières que la prospérité ne discerne pas. Comme c’est vrai. Jusque-là, j’avais vécu sur ma bonne étoile; j’étais gâtée, tout me réussissait et cela me donnait le petit air d’arrogance des êtres qui n’ont jamais souffert. Puis, j’avais évacué de mon âme l’idée de Dieu, je me croyais être au contrôle de ma destinée. Mais, tout d’un coup, la terre s’ouvre sous mes pieds; celui qui occupait presque tout l’espace de mon affection disparaît.
Je ne suis pas ici pour vous dire mon chagrin parce qu’il est indicible et il ne concerne que moi. Je vous dirai cependant le cadeau que m’a laissé cette tragédie. Il peut paraître indécent de trouver du bonheur dans un événement aussi dramatique, mais je veux partager avec vous ce cadeau.
En acceptant d’entrer au plus profond de ma souffrance – car il faut pleurer celui qui est mort pour faire de la place à ce qui s’en vient –, quelque chose me disait au fond de moi : sois patiente, aie confiance, cette souffrance et tout ce travail ne sont pas inutiles. Puis, tout doucement, je me suis imprégnée de la conviction profonde que tout a toujours un sens.
Avec le temps, cette épreuve est devenue purement positive; elle a ouvert une nouvelle époque de ma vie, peut-être la plus riche et la plus précieuse. Il est vrai qu’elle m’a permis de connaître une vie humaine épanouie : j’ai terminé un doctorat en sociologie sur le thème de la mort, je suis thérapeute du deuil depuis bientôt quinze ans et j’ai publié en octobre 2002 le volume Et si la mort m’aidait à vivre? aux Éditions Le Dauphin Blanc. Mais, le plus important, c’est que cette épreuve m’a permis d’aborder une vie transcendante, où j’ai désormais la certitude des choses invisibles, comme dit le Nouveau Testament à propos de la foi. Pour moi, la foi, c’est la certitude du sens que je donne à ma vie et la conviction que chaque événement, chaque situation dans laquelle je me trouve a toujours une valeur positive, même les drames, même les tragédies, même l’éclair dans un ciel serein. Certes, ce n’est pas une bénédiction en soi de collectionner les malheurs, mais c’en est une pour celui qui sait voir, accepter, dépasser la surface de l’existence et qui découvre, au cœur même de l’adversité, une paix et une joie incompréhensibles aux autres.
Le livre : Et si la mort m’aidait à vivre ?
L’auteur : Suzanne Bernard
L’éditeur : Le Dauphin Blanc
Le diffuseur : Diffusion Raffin